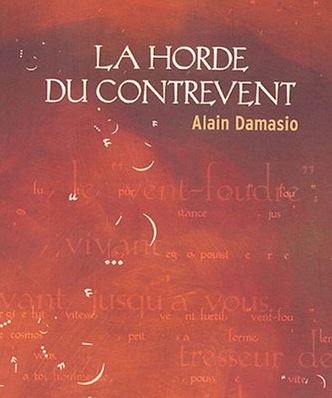commentaires sur le texte de Colin
C'est un texte d'auteur, ce qu'il appelle « lâcher prise », comme geste esthétique, est donc l'explication de sa propre démarche d'auteur, modulée par le fait qu'il est aussi (voyez son blog et ses contributions de critique à Fluctuat) un grand lecteur. Premier aveu de taille, donc : alors que c'est un lecteur rapide, compulsif, et avisé, il ne lit pas de SF pure et dure (comprenez, pour aujourd'hui : Wilson, Egan). La conclusion de l'article est sans appel, en ce sens : « À l'occasion, il faut quitter pour exister, se jeter à l'eau pour comprendre qu'on sait nager. Sans la SF, je ne serais pas là aujourd'hui. Avec la SF, je n'irai jamais très loin ailleurs. » La thèse de Fabrice Colin se développe ainsi : la SF est seulement un laboratoire, et l'occasion d'entrer dans le Jeu. A ce titre, elle perd son statut de fin en soi, en termes littéraires, et n'est plus que la méthode, la disposition d'esprit, qui peut préparer un auteur à se trouver lui-même, la maturité narrative, stylistique, esthétique, venant de livre en livre. La SF n'a plus d'autonomie (ou, à tout le moins, des auteurs comme Colin ne doivent plus lui en donner ou lui en reconnaître une), elle n'est qu'apéritive, préparatoire. Propédeutique à la vraie littérature, celle qui vient. La SF souffre donc du syndrome de Jean-Baptiste : elle annonce quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais la thèse de Fabrice Colin peut, à mon sens, être expliquée, ou prolongée, et ce, justement, en reprenant cette idée d'un « lâcher prise ». Lâcher prise, se laisser porter, envahir, plutôt que lâcher prise au sens d'abandonner le combat rhétorique entre pro-SF et anti-SF sur les forums. L'expérience littéraire clé qu'à mon sens Colin vise, c'est la submersion, ou l'immersion totale, la déprise de soi, ou encore ce que je nommerai, en hommage à Ursula Le Guin, la « troisième dépossession ». Expliquons un peu les choses, nous allons voir que les idées s'enchaînent naturellement en la matière. Dans Les Dépossédés, Ursula Le Guin expose les deux formes de dépossession économico-politique de soi que l'individu doit subir à notre époque : celle de l'individualisme égoïste anti-égalitariste forcené (bref : l'individu coupé du milieu et de la genèse qui l'ont formé), et celle du collectivisme dirigiste furieusement égalitaire (le milieu purgé de toute individualité résiduelle). Dépris d'eux-mêmes, privés d'eux-mêmes, de leur couple et de leurs enfants, les personnages du roman de Le Guin en viennent à rechercher, selon les mots explicitement proférés dans le roman, la « chance » et la « grâce », bref, ce qui les sauverait d'une telle dépossession. Or le geste esthétique de Le Guin, et il est le même que celui de Thomas Pynchon par exemple, consiste à proposer au lecteur l'horizon d'une autre forme de dépossession, d'abandon serein à autre que soi, sans se perdre soi. Les mystiques chrétiens ont nommé cela Gelassenheit : abandon serein et exultant à la vie même, à un milieu qui nous excède, qui nous submerge. Cette expérience est une dépossession, en ce qu'on y est emporté, c'est une dépossession non plus économico-politique, mais esthétique. Elle consiste à reconnaître, en le vivant, en l'expérimentant au plus profond de soi, que l'on n'existe comme individu que lié à un milieu primordial, immense, océanique, qu'on n'existe que porté et poussé dans le dos par les grandes vagues de la vie. La mise en scène de la disparition de l'homme, dans L'arc-en-ciel de la gravité, les luttes effrénées de Jack Flash contre toute forme de pouvoir dans Velum et Encre de Hal Duncan, tout cela commence par la reconnaissance d'un fond primordial d'être immense (le Velum, justement, mais aussi Londres, l'Afrique noire, et tant d'autres lieux dans le livre de Pynchon), présupposent ce fond premier d'être, et de vitalité[1]. Nous venons de plus loin que nous-mêmes, et l'avoir oublié est ce qui rend nécessaire la dépossession esthétique, la reconnaissance que nous ne saurions à nous seuls, nous suffire à nous-mêmes. Geste d'humilité, d'humiliation, et geste que Fabrice Colin avait su accomplir en parlant, avec La Route de McCarthy, de mise en scène d'un « immémorial ». Ce faisant, Colin se rapproche à mon sens de la théorie de l'individu développée par Michel Henry dans ses essais et son roman L'amour les yeux fermés : l'individu n'existe que provenant d'un fond qui le précède, et articulé à ce fond, dont il se coupe illusoirement[2]. Colin n'en reprendra sans doute pas l'argumentaire chrétien, mais il retrouve, à mon sens, cette expérience, et c'est là ce qui est significatif.
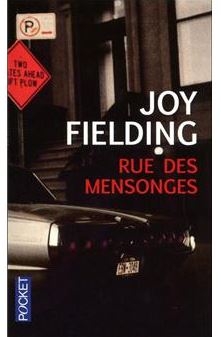 Joy Fielding peut nous faire lire deux pages de disputes conjugales ou de dialogue "bateau" entre copines. Je ne suis pas convaincu que cela apporte au roman autre chose que quelques pages en plus.
Joy Fielding peut nous faire lire deux pages de disputes conjugales ou de dialogue "bateau" entre copines. Je ne suis pas convaincu que cela apporte au roman autre chose que quelques pages en plus.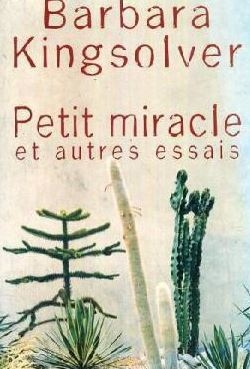 Biologiste de formation, et profondément écologiste, Barbara Kingsolver a une idée très claire des conséquences dans le monde de la politique de consommation aveugle et sourde du gouvernement américain. Ce pays, qui représente 5% de la population mondiale, consomme 1/4 de l'énergie mondiale. Nous faisons nous-mêmes partie des 20% de privilégiés qui utilisons près de 70% des ressources de la planète, et générons 75% de ses déchets.
Biologiste de formation, et profondément écologiste, Barbara Kingsolver a une idée très claire des conséquences dans le monde de la politique de consommation aveugle et sourde du gouvernement américain. Ce pays, qui représente 5% de la population mondiale, consomme 1/4 de l'énergie mondiale. Nous faisons nous-mêmes partie des 20% de privilégiés qui utilisons près de 70% des ressources de la planète, et générons 75% de ses déchets.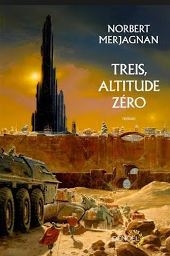 Le premier roman de Norbert Merjagnan, Les tours de Samarante, est un bijou, disons-le d’emblée. Après avoir été, un temps, rebuté par le glossaire de fin de livre – encore un de ces faux créateurs qui pense remplacer des idées absentes par des néologismes creux…
Le premier roman de Norbert Merjagnan, Les tours de Samarante, est un bijou, disons-le d’emblée. Après avoir été, un temps, rebuté par le glossaire de fin de livre – encore un de ces faux créateurs qui pense remplacer des idées absentes par des néologismes creux…